Thé à la menthe
C’était en fin d’après-midi, ou peut-être en début de soirée. Je rentrais d’un voyage de plusieurs jours avec mes enfants et je venais de garer la voiture le long du trottoir de ma maison. Les enfants s’en étaient déjà extraits, impatients de rentrer pour retrouver leurs repères, leurs jouets, leur espace. Les valises étaient en attente dans le coffre. Je venais d’ouvrir le garage où Fatima était censée avoir laissé la clef de la porte d’entrée dans une cachette convenue à l’avance. Avant de garer méthodiquement ma belle bleue, je me mis en quête de la fameuse clef avec une légère appréhension. Et je dus me rendre à l’évidence : point de clef ! J’étais enfermée à l’extérieur de chez moi, avec mes deux marmots… J’aurais pu aller squatter chez des amis pour la nuit, mais j’étais fatiguée par la route et je voulais ressentir, par-dessus tout, ce sentiment voluptueux qui vous submerge lorsque vous rentrez enfin chez vous après une absence prolongée.
Je ne m’expliquai pas tout de suite la raison pour laquelle Fatima, qui était la femme de ménage qui travaillait chez moi, d’une grande probité et d’une totale confiance, m’avait joué ce drôle de tour. Je déduis qu’elle devait avoir une bonne raison. Elle était trop avisée pour être coupable d’un simple oubli. Il ne me restait plus qu’à la retrouver… Mais je ne me rappelais jamais son nom de famille (aujourd’hui encore, je n’y arrive pas) et, bien qu’ayant déjà été la ramener en voiture à la lisière du douar, je n’avais jamais eu l’occasion d’y entrer. Ce n’était pas le genre d’endroit où on allait se promener avec un appareil photo en bandoulière… Je ne connaissais donc en clair, ni son nom, ni son adresse.
Armée de ces précieux renseignements, j’embarquai ma progéniture en direction du douar. Comme beaucoup d’autres, il s’agissait d’une sorte de petit village à la lisière de la ville, constitué de maisons construites généralement en dur, mais qui ressemblait extérieurement à un bidonville, avec ses tôles ondulées, sa misère crasse à fleur de murs, mais aussi ses petits commerces, son linge suspendu comme à la dérive sous un soleil de plomb, son fourmillement de vies, et l’enfance omniprésente.
Je garai ma Tercel dans la rue aux allures de piste qui s’achevait à l’entrée du douar. Je savais ne rien risquer, là. J’allais fatalement attirer l’attention avec mes cheveux clairs et ma peau blanche, mais je ne m’engageais pas dans un repère de coupe-gorges. Il y avait des quartiers, à Casablanca, distante d’une quarantaine de kilomètres, où aucun français, aucun marocain sensés, n’auraient mis les pieds sans une excellente raison. Dans ces bidonvilles-là, vivaient, vivent encore, des hommes, des femmes, des enfants qui n’ont le plus souvent ni eau courante ni tout-à-l’égoût, et qui ne sont jamais sortis de la frontière imaginaire qui les sépare de l’autre vie. Là-bas, règnent la contrebande, la pauvreté jusqu’à la nausée, la violence aveugle et les noyaux islamistes. Pour certains de ses habitants, la première et dernière descente dans le centre illuminé et bruyant de Casablanca, exubérante de luxe et de profusion, fut à l’occasion des attentats perpétrés le 16 mai 2003 et qui firent 42 morts. Le seul qui en ressortit vivant fut exécuté à l’issue de son procès.
J’étais bien loin de tout cela.
Je m’engageai dans l’allée longée de baraques blanches au toits plats, cellules réduites aux portes métalliques peintes en bleu, vert ou gris. Des fenêtres carrées, minuscules. Autour de moi les regards se figeaient quelques fractions de seconde sur notre présence inattendue. Nul Français dans les bidonvilles.
Je frappai à la première porte.
Mes enfants s’inquiétaient. La jour commençait à tomber, et aussi trempés qu’ils fussent dans la société marocaine, ils n’avaient jamais, à l’instar de bien des marocains eux-mêmes, mis les pieds dans un bidonville. Je les rassurai un peu, je me sentais moi-même en sécurité. Une jeune femme m’ouvrit, un foulard clair sur la tête, un peu farouche. Je lui expliquai en arabe que j’étais à la recherche d’une femme d’une quarantaine d’années, veuve, mère de deux enfants, qui travaillait chez moi et que je devais absolument voir. Ces indications étaient insuffisantes, mais elle avait quelque idée sur la question et me répondit qu’elle aurait pu m’aider, mais qu’elle ne pouvait pas sortir car son mari n’était pas là. Je la laissai donc là après l’avoir remerciée. C’était une jolie fille, d’une vingtaine d’années, cloîtrée chez elle au milieu d’une famille nombreuse et prématurée. Dans les classes sociales les plus pauvres, il existe encore des femmes totalement sous l’emprise de l’homme, au Maroc. Et pas seulement dans les campagnes.
Je recommençai la même opération un peu plus loin. Mes enfants étaient mal à l’aise, peut-être sentaient-ils la fracture irrémédiable qui les séparait de ceux qui auraient pu être leurs camarades, déguenillés, recouverts de terre, de poussière, abandonnés de Dieu, qui couraient ça et là. Mes enfants sont marocains. Français sur le passeport et par transmission de la culture et de la langue maternelles, mais ils ont passé leur vie en Afrique du Nord. Mon fils voulait rentrer. Ma fille, plus âgée, plus mûre et plus courageuse, était néanmoins tendue, anxieuse. L’obscurité qui augmentait n’arrangeait rien. Je me moquai gentiment de leur frayeur pour dédramatiser.
Mon deuxième contact ne fut pas plus fructueux.
Je décidai de ne pas repartir sans Fatima et d’aller plus avant. A mesure que nous avançions, je reconnaissais les odeurs de la pauvreté, mêlées d’épices pourtant. De jeunes enfants circulaient, nous dévisageaient, et repartaient promener leur insouciance un peu plus loin. Les adultes passaient leur chemin. Ils portaient déjà, dans les traits de leurs visages, dans ces rides qui ne doivent rien au soleil, le poids de leur misère tue. Ces visages graves, pudiques, résignés à la souffrance dans un abandon religieux, ne se décrivent pas. Au demeurant ceux-là n’étaient pas les plus pauvres. Les plus pauvres ne se voyaient pas là. Non, ceux-là travaillaient pour certains, et leurs salaires dérisoires leur permettaient de survivre et de subvenir aux besoins les plus élémentaires de leurs familles.
J’aperçus alors un peu plus loin le seul endroit où sont concentrées, dans un quartier marocain, toutes les informations concernant ses habitants, du registre d’état civil aux potins les plus divers : l’épicerie. Celle-là était de la taille d’une buanderie, et comme souvent, le commerçant vous servait au comptoir, on demandait ce qu’on voulait. Dans la petite pièce dépourvue d’ouverture où étaient concentrés tous les produits en vente, l’alimentaire prenait la plus large part, mais on trouvait aussi un peu de tout. Je faisais parfois quelques courses dans ces échoppes. Contrairement aux vrais magasins fréquentés par les touristes ou les européens résidents, les prix étaient les mêmes pour tout le monde et ils étaient tout à fait abordables. Enfin le regard était plus sain, la relation dénuée d’avidité ou d’envie.
Le marchand était assez jeune, avenant, poli et souriant. Lorsque mon tour vint, je lui resservis mon discours désormais rodé, assorti des formules de politesse idoines. Il réfléchit longtemps, posa les questions appropriées pour essayer d’affiner sa recherche. Je finis par lui donner une indication qui sembla être décisive : elle avait travaillé pendant dix ans dans une famille d’espagnols. Je lui dis de me montrer le chemin, mais, bien mieux avisé que moi, il appela un jeune pour m’accompagner. L’adolescent l’écouta et se mit en marche, nous devançant au début d’un ou deux pas. Il allait manifestement au terrain de foot (ce qui en tenait lieu) au moment où l’épicier l’avait interpelé. Il portait en effet un short et de vieilles chaussures de sport d’un autre âge. Il était torse nu. Il avait obéi au marchand comme s’il se fût agi de son propre père. Sans réfléchir et sans répondre. Non pas qu’il s’en moquât, ou que servir de guide à des inconnus le passionnât. Mais l’épicier était un homme respecté et nécessaire, au demeurant peut-être sympathique. Je parvins néanmoins, sur le chemin, à lui adresser la parole et à le dérider un peu.
Nous nous engageâmes rapidement dans des ruelles assez étroites pour que deux personnes qui se croisent se frôlent les coudes. Les odeurs devinrent étouffantes. Une rigole courait le long des ruelles, dans leur milieu, pour évacuer les eaux usées. Une odeur pestilentielle s’en dégageait sous l’effet de la chaleur, lorsque l’eau venait à stagner trop longtemps. Le linge courait le long des murs, pour sécher, se ressalissant aussitôt au passage des enfants, au contact d’une poussière omniprésente ; quelques adultes bavardaient assis devant les portes, rétrécissant encore le passage. Ils nous jetaient alors un regard intrigué. Notre jeune guide s’adressa un peu plus loin à l’un d’eux pour savoir si Fatima serait chez elle. On nous répondit par l’affirmative. J’abandonnai rapidement l’espoir fou que j’avais caressé au début de notre plongée : il n’était pas très réaliste de retourner à la voiture sans guide… Le douar dessinait un labyrinthe dont un Dédale n’aurait pas eu à rougir !
La lumière était désormais rare, les odeurs se faisaient plus prégnantes, celles du dîner venaient se mêler avec un bonheur inégal aux remugles pestilentiels de la ruelle. Une atmosphère de fourmilière régnait partout ; une impression de vies mêlées, étroitement tissées, indissolublement entrelacées, se dégageait de ces tableaux de vies torturées à la tombée du jour, de ces destins scellés dans l’enfer. Mes enfants tentaient maladroitement de ne pas glisser dans la rigole en contenant tant bien que mal leur répugnance, et l’étroitesse nous contraignait à marcher à la queue leu leu. Leur angoisse s’amplifiait, bien qu’ils fussent en partie rassurés par la certitude de retrouver Fatima, qu’ils adoraient. Cette pauvreté indescriptible leur était désormais palpable, inconcevable un quart d’heure plus tôt.
Nous arrivâmes enfin chez Fatima. Notre guide nous quitta rapidement. Il nous oublierait bien vite. Elle nous accueillit avec sa fille dans de grandes effusions de joie et de longues accolades puis nous passâmes quelques minutes à échanger des mots agréables, des mots de retrouvailles. Elle nous avait fait entrer dans un petit salon aux murs de ciment, sans peinture, seulement habillé par les canapés marocains qui couraient le long des murs. La pièce trop chaude en raison de la tôle ondulée qui servait de toit, très sombre, était néanmoins accueillante. Les murs nus, le décor de mauvais goût, tout respirait la difficulté à vivre, la simplicité et la décence. Quelques images de mon enfance remontèrent en surface. Je souris malgré moi à cette évocation. Les bruits de la ruelle avaient cessé depuis que la porte s’était refermée derrière nous, l’ampoule nue au plafond suffisait à peine à éclairer la pièce. Après avoir pris les incontournables nouvelles de ma famille, de la sienne, nous en vînmes à évoquer le problème de la clé, qu’elle me remit en m’expliquant qu’elle craignait que n’importe qui ne la prenne car la fermeture du garage n’était pas assez sûre. Je sirotai un verre de thé à la menthe. Mes enfants burent du coca. Ils étaient un peu gênés dans ce décor austère, malgré la gaité naturelle et la spontanéité de Fatima. Ils voulaient rentrer mais je me sentais bien, là. Nous bavardâmes encore de longues minutes. Son père était paralysé et vivait dans la pièce à côté, le mien vieillissait et était malade.
Fatima finit par me raccompagner pour sortir du douar, je n’eus nul besoin de lui expliquer que je me serais perdue sans un autre guide pour le retour. Elle était à l’aise dans son quartier, à l’aise dans le mien. Elle maîtrisait, bien mieux que moi, les deux vies. Il faisait nuit noire désormais. Le silence, quant à lui, tomberait beaucoup plus tard sur cette misère rendue invisible pour quelques heures. La vie, indifférente, n'avait pas cessé.
Cette femme était intelligente, douée, parlait l’espagnol, l’arabe bien sûr, et commençait à connaître quelques mots en français (nous communiquions en arabe au quotidien). Elle ne manquait ni de qualités humaines, ni de qualités morales. Elle était d’une ouverture d’esprit et d’une écoute exceptionnelles. Et elle était bien plus compétente que moi dans tout ce qui touchait à ses fonctions. Pas une seule fois je ne l’ai entendue se plaindre de sa vie. Elle n’en était pas pour autant moins lucide. Elle était pour moi un exemple de courage. L’école s’était arrêtée très tôt pour elle et son salaire de nourrice-femme de ménage lui permettait de faire vivre sa famille. Elle élevait ses enfants seule. Comme moi. Nous parlions souvent.
J’ai laissé quelques amis là-bas, mais Fatima est une des premières personnes que je retournerai voir chez elle lorsque je reviendrai au Maroc. Elle le sait.

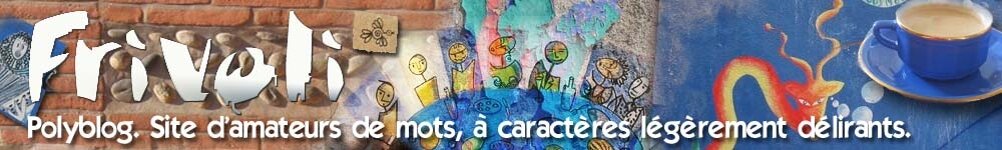
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fwww.label-emmaus.co%2Fstatic%2Fopengraph%2Flabel-emmaus.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)