21 septembre 2001
Ce triste jour, tragique pour beaucoup à Toulouse et au-delà, eut lieu dans ma vie le 25 novembre de l'année suivante.
"Mohammedia (arabe: المحمدية) est une ville du Maroc située entre Rabat et Casablanca. Elle abrite la principale raffinerie du Maroc." (Wikipédia)
Je conduisais beaucoup plus vite que de coutume, et pas assez encore à mon goût.
Il était tard. Il faisait nuit. Minuit, peut-être ? Il fallait
atteindre Casablanca le plus rapidement possible. Il y avait longtemps
que l'autoroute était fluide ; les bouchons monstrueux des heures
précédentes, avec leur interminable caravansérail de voitures remplies
de quelques maigres affaires emportées à la va-vite, bourrées à craquer des membres de la famille, de
quelques voisins au désespoir de s'échapper, en proie à une panique
totale, déchaînée, avec leurs conducteurs tous frappés de terreur, ivres de rage devant le piège qui menaçait de se refermer
sur eux, ceux-là, à l'abri maintenant, soulagés enfin, avaient laissé place
à un trafic tendu, nerveux, rapide, mais clairsemé. Fuir... Coûte que
coûte... Mais vite... Mon ex-mari se tenait assis à ma droite, prostré,
encore en état de choc. Néanmoins il parvenait maintenant à s'exprimer
de façon cohérente et à me répondre lorsque je lui adressais la parole.
Il était trempé jusqu'aux os, des épaules jusqu'aux pieds, d'une eau
sale et boueuse, peut-être toxique. Surtout, ne pas ralentir. Surtout,
ne pas se retrouver bloqués par une voiture en travers de la voie, sans
lumières, accidentée, surtout ne pas perdre le contrôle. Mettre des kilomètres entre ma Tercel bleu et cet
enfer d'hydrocarbures. Je voyais défiler mentalement les kilomètres.
Les vingts premiers furent interminables...
Nous savions que si la
plus grosse des cuves explosait, tout serait entièrement dévasté sur un
rayon de plus de 30 kilomètres...
Le 25 novembre 2002, aux alentours de 17 heures,
je rentrais tranquillement du lycée de Casablanca chez moi, Mohammédia,
Maroc. Pour cela, je longeais la côte atlantique à ma gauche ; par
endroits on entrevoyait l'océan. Ce jour-là il faisait bleu et or,
soleil et mer. Je devais être heureuse de rentrer chez moi, comme
d'habitude, et lorsque j'entrai dans ma ville, je ne m'attendais
certainement pas, en jetant négligemment un regard sur ma droite, en
direction du pont qui surplombait l'oued El Maleh, à cette vision de
cauchemar qui me glaça le sang en une fraction de seconde et me fit
ralentir malgré moi... Le pont n'était plus visible.... Cet oued que
j'avais souvent vu presque à sec, était gorgé de flots monstrueux et
ininterrompus qui recouvraient le pont complètement. L'eau s'écoulait
vers l'océan. Elle venait de loin et il y avait lieu de croire que ce
serait bien pire ailleurs, dans le nord, notamment. Les pluies
diluviennes qui s'abattaient sur le Maroc depuis plusieurs jours
avaient transformé cet oued paisible en un torrent boueux. Quelques
coups de fil passés en arrivant à la maison. Rien de très alarmant.
Après dix ans de sécheresse, la saison des pluies reprenait ses droits
et s'imposait avec violence. Pour l'heure, la topographie de la côte
pouvait absorber et correctement diriger les eaux vers l'océan. Pour
l'heure... Mes enfants étaient chez leur père, dans la ville basse, à
quelques centaines de mètres de l'oued. Je lui proposai de prendre les
enfants, insistai, mais en vain. Il n'était pas inquiet.
D'ailleurs, qui l'était ?
Je vivais alors dans la ville haute et dès lors que je fus rentrée chez
moi, malgré une certaine appréhension, je vaquai à mes occupations
quotidiennes. Néanmoins, en début de soirée, les appels téléphoniques
se multiplièrent qui signalaient que des quartiers de la ville basse
commençaient à être inondés. L'oued était en crue, la situation n'était
plus sous contrôle, mais l'eau ne pouvait monter indéfiniment,
pensait-on. Je gardais le contact avec mon ex-mari, il pensait pouvoir
rester au premier étage de sa villa située près de la mer, dans le
quartier de l'école des enfants. Mais qui alors aurait pu imaginer ? Je
suggérai plus fermement de prendre les enfants. Mais il était déjà trop
tard. Les voitures ne pouvaient plus circuler. Le niveau de l'eau était
déjà trop élevé. Il faudrait patiemment attendre que le pic soit
atteint pour que le niveau redescende lentement.
J'appris plus
tard par les enfants que leur père avait commencé à s'affoler lorsqu'il
avait vu sa voiture flotter dans la rue. Le niveau de l'eau ne cessait
de monter, et à l'incrédulité du départ succédait désormais la peur
diffuse d'une grande catastrophe. Les constructions misérables au bord
de l'oued, construites sans structures solides, commençaient à céder,
tous fuyaient. Une heure plus tard, vers 19 heures si je me souviens
bien, la situation était officiellement critique et plus personne ne se
voilait la face. Dans la ville basse, certains quartiers qui abritaient
le centre névralgique de la ville, disparaissaient sous un peu moins de
deux mètres d'une eau fangeuse et très probablement toxique en raison
de la proximité de la plus grande raffinerie de pétrole du pays et
d'autres centres industriels et chimiques des environs immédiats, pour
ne rien dire des égoûts qui refluaient massivement. Mon fils, alors
âgé de six ans, ne savait pas nager. Cent cinquante mètres environ, pas
davantage, séparait le père avec ses deux enfants de la terre ferme. Il
n'était pas pensable de tenter l'aventure pourtant. Les courants
puissants provoqués par les bouches d'égoût, si celles-ci, par malheur,
n'étaient pas encore obstruées, les auraient tous balayés et noyés,
adulte et enfants. Ils étaient piégés au premier étage d'une villa, la
tête à la fenêtre, regardant l'eau monter inexorablement, se rapprocher
d'eux avec une certitude désormais incontournable. De l'avant de la
maison, ils pouvaient voir, quelques mètres plus loin, la terre ferme
et les attroupements de gens qui s'affairaient, qui s'inquiétaient des
leurs. Les zodiacs commençaient à circuler, récupérant au passage amis
ou parents. Le jour tombait désormais. Les lumières de la ville ne
tardèrent pas à sauter. Il était impossible aux enfants de s'échapper
par le devant. Mais il était extrêment dangereux, quel que soit le
moyen utilisé, de risquer de se frayer un improbable chemin à travers
les courants à l'arrière de la maison. Elle donnait sur la partie de la ville la plus profondément inondée, vers l'océan. La raison suggérait donc de
rester patiemment chez soi. D'ailleurs, il semblait que l'eau montât
plus lentement désormais.
Il faisait nuit. Nuit noire. Je
continuais à joindre régulièrement mon ex-mari au téléphone, mais son
portable était déchargé et nous serions bientôt dans l'impossibilité de
communiquer...
C'est à ce moment-là que le premier incendie se
déclencha à la Samir, nom donné à la société d'exploitation de la
raffinerie de pétrole. Pour moi comme pour tous, cela signifiait une
grande probabilité d'explosion d'une ou de plusieurs cuves. Les sirènes
tant redoutées retentirent aussitôt avec insistance dans toute la
ville. Désormais, nous avions quelques minutes pour tenter de gagner
Rabat, première ville sûre. A cinquante kilomètres. Avec un seul accès
désormais puisque l'autre était bloqué par l'inondation. Un seul accès,
une autoroute. Pour 30 000 habitants. La panique, la cohue, les images
de détresse et d'incompréhension, je ne les raconterai pas, je ne les
ai pas vues. On m'en a parlé. Pour moi, nulle fuite pour l'heure. Je ne
serais pas partie sans mes enfants. J'ai senti les jambes se dérober
sous moi, et à l'heure où j'en parle, ou j'écris ce texte, les
souvenirs, les émotions affluent à nouveau, identiques. J'appelai
aussitôt leur père. Exigeai qu'ils organisent leur fuite, quel qu'en
soit le moyen, c'était désormais d'une importance vitale. Car depuis
quelques minutes à peine, la crue de l'oued El Maleh, qui avait alors
atteint sont pic à 1m90 dans la ville basse, n'inquiétait plus grand
monde. A quelques centaines de mètres un peu plus au nord sur la route
de Casablanca, les immenses cuves vertes de la Samir, devant lesquelles
j'étais passée en fin d'après-midi avec la même insouciance
quotidienne, menaçaient de réduire en poussière la ville entière et
jusqu'à Casablanca, à une quarantaine de kilomètres, que tous
déconseillaient de rejoindre au profit de Rabat, plus éloignée.
Le
coeur en lambeaux, les jambes tremblantes, je me précipitai vers ma
voiture dans un état second et l'esprit paradoxalement clair et
déterminé. Il semblait que l'esprit prît le relais d'un corps tout près
de flancher. Je roulai vers la ville basse, aussi près que je pus de la
villa de mes enfants, pas même visible depuis mon stationnement. Je
pris soin de me garer au sec, juste assez haut pour que la voiture soit
logiquement à l'abri même si l'eau montait à nouveau un peu, pas trop
loin au cas où, si nous sortions de ce bourbier vivants, nous puissions
quitter la ville. Car à ce moment-là, en regardant autour de moi les
voitures partir, les gens se contacter par téléphone pour organiser
leur fuite, en voyant les rues se vider brusquement, je compris que ce
soir, ce serait peut-être fini. Que ce soir, ce serait au Maroc, à 36
ans, dans un accident industriel majeur, avec deux gosses de 6 et 10
ans. Pulvérisés. Coup de fil de mon ex-mari depuis le portable d'un ami
: le téléphone était déchargé. Nous ne pourrions plus entrer en
contact. Ils allaient essayer de sortir par l'arrière, côté inondation.
Des hommes. Des femmes. Nombreux. Parents ? Amis ? Je l'ignore. Des
curieux qui ne pouvaient plus fuir, pour certains, parce qu'ils
n'avaient pas de voiture, ou qu'ils n'y croyaient pas. Certains
disaient que c'était inutile, qu'il valait mieux risquer de mourir sur
le coup, au plus violent du cataclysme, plutôt que d'être handicapé à
vie en tentant de s'échapper. Le noir, plus de lumière. Certains ont
des torches. On m'en prête une. J'essaie de voir, d'évaluer, de
comprendre. La rue qui donne sur le quartier sinistré est courte,
quelques dizaines de mètres seulement. La première maison est habitée
par mes enfants. Mais bon Dieu ! Pourquoi est-ce si loin et si près ?
Pourquoi est-ce impossible ? L'Enfer m'est alors apparu. Ce matin,
j'enseignais à des enfants de la classe bourgeoise du poumon industriel
et financier du pays, et ce soir, nous allions traverser la nuit la
plus longue de nos vies, sans savoir si le soleil se lèverait à
nouveau. Un bateau pneumatique revenait du quartier inondé, chargé de
quelques habitants, ceux-là seraient saufs, peut-être. D'autres
bateaux, quelques zodiacs, circulaient dans les rues invisibles de la
ville, transformées en canals, simplement délimités sur les côtés par
les palmiers qui sont là-bas ce que sont nos platanes ici. Le bateau
n'était plus très loin, et je ne comprenais pas encore pourquoi il
n'était pas davantage chargé. Des centaines de personnes étaient
évidemment bloquées, tous n'étaient pas motorisés dans ce quartier de
classe moyenne ou n'avaient pas pu fuir quand il était encore temps.
Il faisait nuit. Je comptais me frayer un chemin pour m'imposer sur la
barque et repartir au prochain voyage, pour chercher mes enfants. Je ne
savais où. Je ne savais comment. Les pompiers attendaient le bateau,
s'affairaient, donnaient quelques consignes.
C'est à cet instant
précis qu'eut lieu la première explosion, violente, assourdissante, à
l'instant où le bateau s'approchait de la terre ferme. Un souffle
chaud, puissant, me balaya le visage, une suffocante odeur de soufre
m'emplit les narines, mais c'est en levant lentement la tête, comme
irrésistiblement attirée par une image terrifiante que l'on voudrait ne
jamais voir, que je compris. Peu à peu. Car il semblait soudain que la
nuit s'était épaissie. Oui, c'était cela. La nuit. Je regardai autour
de moi. Beaucoup avaient instinctivement levé les yeux vers le ciel,
eux aussi. Un immense nuage noir repoussait rapidement le voile bleu
nuit des ténèbres, envahissait le ciel au-dessus de nous. Pour retomber
bientôt... Le pétrole... L'odeur était prégnante, pénible. Probablement
toxique. A ce moment-là, nul ne pouvait juger de la gravité ou de
l'imminence d'une dernière et fatale explosion.
Tandis que
beaucoup, comme moi, quelques secondes pétrifiés, sur le bord,
observaient le ciel, tous les autres, pompiers, voisins, badauds,
parents et amis, tous foutaient le camp dans le plus grand désordre.
Les pompiers furent les premiers, donnant le signal de départ des
derniers indécis. Merde, le bateau... ! Je me vis alors m'enfoncer dans
l'eau, chevilles puis mollets, en direction de la barque, et parler
avec les bénévoles. Non, nous n'y retournons pas, il faut partir... Je
dois récupérer mes enfants... Il n'y a plus rien à faire, c'est trop
dangereux... Je vous en supplie, je ne peux pas partir sans eux... La
Samir est en flammes, les cuves peuvent sauter d'un moment à l'autre...
Je n'ai pas le choix... Silence... Regard... D'accord... Deux ou trois
autres étaient avec moi, voulaient retrouver un parent, rejoindre une
famille.
Pendant notre conversation, toute vie humaine avait
déserté le quartier, laissant place désormais à la nuit noire
d'hydrocarbures et au silence de l'attente.
Nous partîmes
lentement, deux hommes pagayaient, prenant soin de se repérer à travers
les porches désormais invisibles des immeubles, les toits des commerces
aux contenus entièrement noyés. Nous avions rapidement atteint la zone
la plus inondée, et ce boulevard Yacoub El Mansour, que je prenais tous
les jours pour amener mes enfants à l'école, m'apparut étranger. Je ne
voyais plus rien, ne reconnaissais rien. L'épais nuage consécutif à
l'explosion et à l'incendie (aux incendies ?) rendait la visibilité
dérisoire, les torches éclairaient faiblement. J'entendais
distinctement le clapotis de l'eau à chaque fois qu'une rame entrait
dans cette eau nauséeuse. Désormais, nous étions seuls.
Alors que
nous longions les palmiers, je vis une tête émerger de l'eau, plaquée
contre le tronc d'un palmier. L'homme ne réagit pas à notre passage. Les
pompiers discutèrent. Le prendre ? Non... On ne peut pas prendre tout
le monde, ni s'arrêter partout... Tu ne peux pas le laisser là !... Il
faut se dépêcher !... Retourne, on doit le récupérer !... C'est un être
sans vie apparente qui fut remonté dans le bateau, totalement tétanisé,
muet de terreur. Pendant les quelques heures (Dieu que c'est long,
quelques heures... !) que dura notre descente en Enfer, il ne prononça
pas un mot, ne remua pas d'un centimètre. Il vivait pourtant,
manifestement. Mais de cette vie d'où l'âme s'est échappée par une nuit
improbable.
Comme nous entrions précautionneusement dans le dédale
des ruelles du quartier inondé, je commençai à lancer des appels
désespérés en direction du vide, appelant mes enfants comme une chatte
ses petits, toute pudeur évanouie, dans les entrailles d'une ville
agonisante, toute entière engloutie par le silence de cette nuit d'une
noirceur artificielle. Le bateau voguait au milieu de voitures
flottantes, et nous prenions grand soin de les éloigner de la paroi du
pneumatique... Une éraflure pouvait nous être fatale... Nous étions
loin désormais de la ville sèche, et nous ne quitterions cet enfer
qu'en bateau.
Des cris aux fenêtres, des femmes qui supplient...
Mais nous nous éloignons... Les bénévoles refusent de s'arrêter,
promettent hypocritement de revenir plus tard, bien sûr... Mais ils
savent... Ils savent qu'ils mourront peut-être ce soir, piégés dans ce
magma sombre d'eau fangeuse sous leurs pieds, dans leurs appartements,
emprisonnés sous ce voile opaque et étouffant de fumée, pendant que
sous leurs yeux, quelques mètres plus bas, un bateau pneumatique à
moitié vide poursuit sa route, entêté et sourd à leurs appels. Et
maintenant je comprends... Pourquoi le bateau était vide tout à
l'heure... Nous approchons d'un porche que l'un des occupants du bateau
veut atteindre pour rejoindre sa famille. Alors c'est la cohue, les
occupants de l'immeuble, s'approchent, de l'eau jusqu'aux épaules, et
tentent de monter dans le bateau dans un mouvement désespéré. Cela
devient très vite dangereux. Personne ne ressortirait vivant de cette
expédition-là. D'autorité, le pompier les repousse sans ménagement et
repart après avoir déposé un des occupants et pris une ou deux autres
personnes après négociations. C'est affreux... Ignoble sélection de la
vie... Nous nous éloignons, je ne vois toujours rien qui ressemble à
mes enfants, il y a des attroupements aux porches des immeubles, mais
il est dangereux de s'approcher, le bateau serait pris d'assaut,
renversé. Le silence à nouveau. Repousser les voitures qui s'approchent
trop près. Le silence toujours. Le clapotement de l'eau... Un autre
zodiac nous croise... Une heure passe ainsi... Avant que je ne finisse
par comprendre que nous sommes en fait complètement perdus et que les
occupants du bateau ne retrouvent plus leur maison dans leur propre
quartier ! On voit des toits, le haut des porches surélevés, les
étages, les premières palmes des palmiers ne sont plus très loin de nos
têtes... Je parle peu, essaie seulement de comprendre où on va si
lentement... Retrouver une maison dans un dédale dont nous connaissions
tous hier les moindres recoins...
C'est ma fille qui me vit la
première... Cette fois, je sais où je veux aller et je le fais savoir
clairement ! Ils sont là, eux aussi sous un porche surélevé. Mes deux
enfants sont perchés tous deux sur les épaules de leur père, au bord de
l'épuisement physique et psychologique. Il s'approche ainsi harnaché
tandis que nous gagnons l'immeuble où ils ont essayé de trouver refuge
après avoir sauté du premier étage de la maison. L'eau a commencé à
baisser déjà, mais il en a encore jusqu'aux épaules, les jambes des
enfants baignant largement dans les eaux.
Ils montent.
Retrouvailles. Questions des enfants. Va-t-on mourir ? Désormais les
occupants de la barque se disputent dangereusement. Tous veulent
quitter cet Enfer et un dernier s'y oppose avec une violence qui nous
fait redouter le pire. Car une seconde explosion vient de retentir et
nous sommes toujours perdus, incapables de nous repérer et de sortir de
ce bourbier.
Notre errance durera encore une heure, peut-être
davantage. J'ai le souvenir qui flanche, ce sont des images qu'il me
reste de ce passage-là. Des odeurs. Des sensations. Les voitures à
travers lesquelles il faut louvoyer, les cris désespérés aux fenêtres
qui déchirent le silence de la nuit. Les questions des enfants. Le
regard prostré de leur père. Ma peur absurde que je meure dans la
prochaine explosion et que mes enfants me survivent, handicapés à vie.
Cette terreur inattendue me poursuivra jusqu'à ce que nous sortions de
la barque pour poser enfin le pied sur la terre ferme, guidés par les
pompiers qui semblaient retrouver leurs repères à mesure que le niveau
de l'eau baissait quelque peu. La noirceur du ciel. Les questions des
enfants.
Le clapotement de l'eau, comme une obsession indécente dans le silence.
On va mourir, maman ?
Je déposai mon ex-mari sur une aire de l'autoroute, un ami allait venir le chercher. Rapide coup de fil. Non, sa seconde épouse ne viendrait pas. Je me tus. Nous nous comprenions. Ce naufrage-là en annonçait d'autres dont aucune barque ne le sauverait...
Ce n'est pas le chaos, ni les hurlements de
désespoir. Ce n'est pas tant non plus la panique incontrôlable ni la
fuite désespérée d'une foule en désordre. Non. L'image qui me poursuit
depuis cette nuit-là, prégnante comme les rémugles pestilentiels d'une
chair pourrissante, c'est celle du silence assourdissant de la nuit,
de l'attente insoutenable d'une mort collective imminente...
Et le clapotement régulier de l'eau.

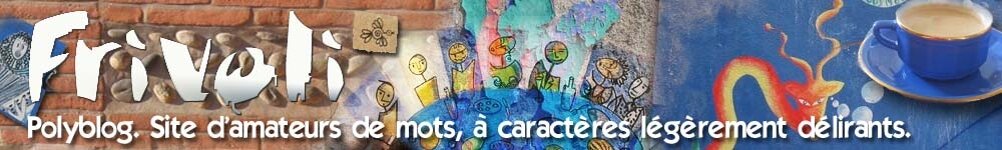
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fwww.label-emmaus.co%2Fstatic%2Fopengraph%2Flabel-emmaus.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)